
The Hum
—
Sortie le 12 mai 2023
—
Warp Records
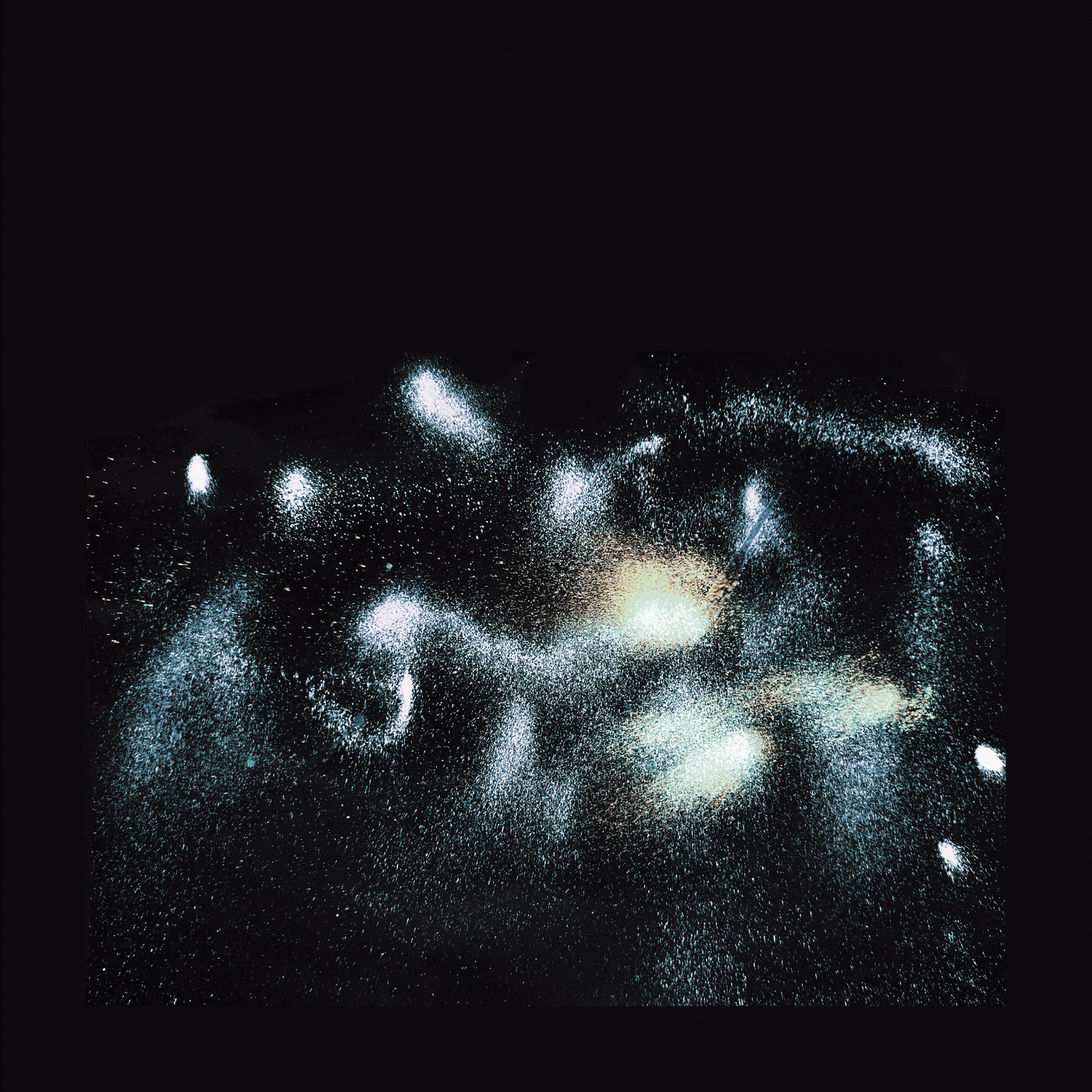

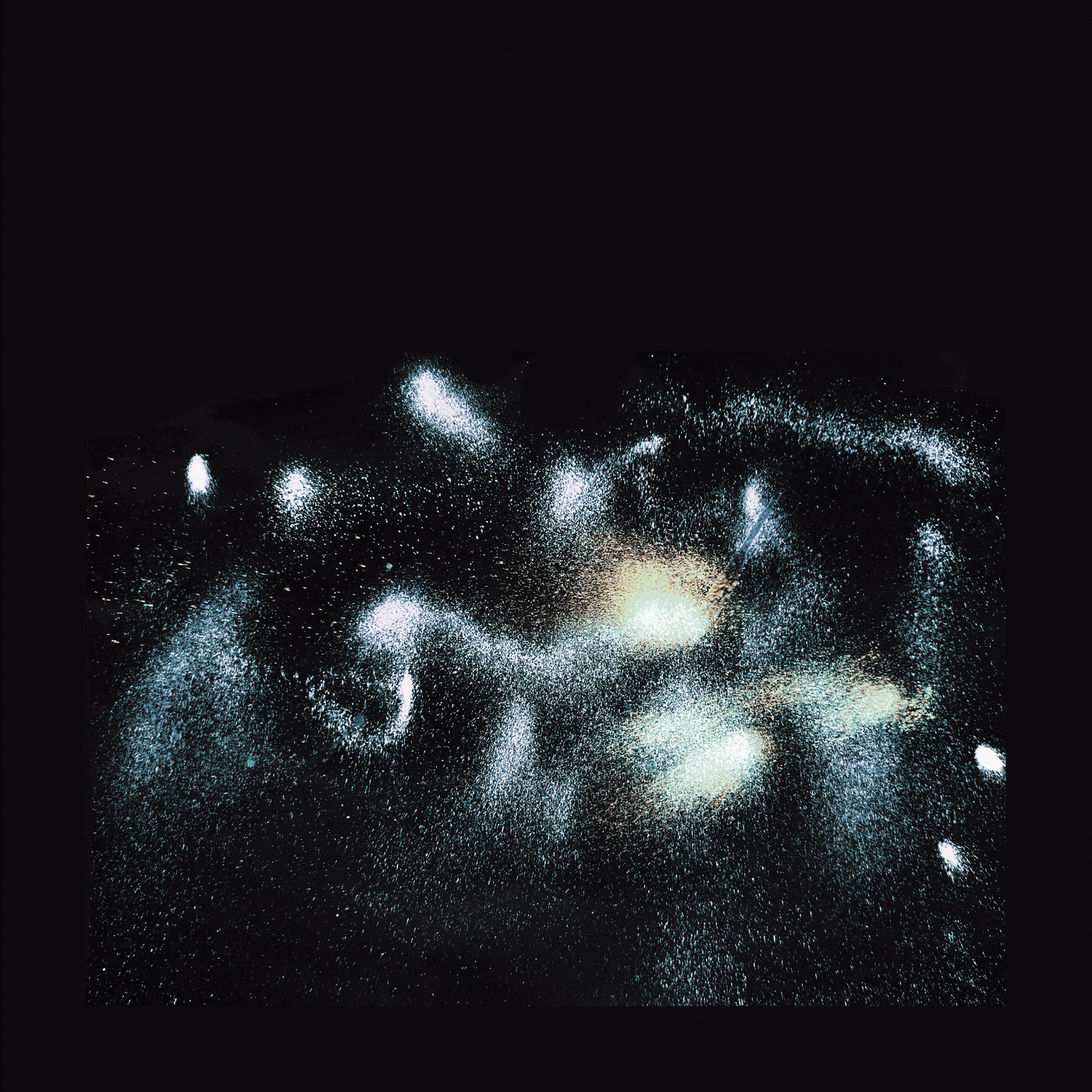
James Ellis Ford s’est tenu à l’abri des regards durant ses vingt ans de carrière. L’auteur-compositeur, multi-instrumentiste et producteur a travaillé avec certains des plus grands noms de la musique, d’Arctic Monkeys à Depeche Mode en passant par Foals, Gorillaz et Kylie Minogue, en se consacrant tellement au succès de ces projets qu’il s’effaçait lui-même quasi totalement. Y compris au sein du duo Simian Mobile Disco, aux côtés de son partenaire artistique de longue date Jas Shaw, ou durant les tournées de The Last Shadow Puppets, son rôle a souvent semblé désintéressé, au service d’un objectif collectif. Mais pour la première fois, il est sur le point d’occuper à son tour le devant de la scène.
Il a habilement évité l’option trop évidente de recourir à ses contacts pour produire un album pop digne de ce nom avec une pléiade de stars. Il a ignoré la tentation commerciale de la dinguerie hip-hop style méga-producteur rappeur. Et il a même refusé catégoriquement d’occuper le terrain confortable d’une dance ultra raffinée ou de l’électro abstraite. A la place, il a sorti l’un des albums les plus envoûtants et convaincants de 2023, tout à la fois hommage à la pop anglaise tendre et excentrique de Brian Eno et de Robert Wyatt, et lettre d’amour aux racines palestiniennes de sa femme et de son fils. Une incursion dans le rock progressif de Canterbury nourrie aux dynamiques du hip hop moderne. Un voyage musical de folie dans l’inexploré, aussi bien qu’une série d’hymnes classiques et bouleversants à l’écriture brillante. Avec The Hum, James Ellis Ford est enfin sorti de sa tanière.
L’album trouve son origine dans sa décision de bâtir un studio dans la maison familiale en 2017, pour s’offrir le luxe de l’expérimentation sonore. Mais dès que la construction a été achevée, sa vie a radicalement changé à d’autres égards. Il est devenu papa pour la première fois (« La vie de famille nourrit cet album. »). Le fait d’avoir une pièce insonorisée remplie de matériel lui permettait d’allumer un synthé modulaire ou même de jouer de la batterie sans réveiller son petit garçon qui dormait en bas.
Mais il y a aussi eu de mauvaises nouvelles. Jas Shaw, son partenaire au sein de SMD, a reçu un diagnostic d’amylose AL, une maladie rare, ce qui a mis Simian Mobile Disco en pause. « Ça a mis fin aux tournées et même à notre travail en studio (pour sa sécurité), explique James. Le fait de ne pas avoir Simian Mobile Disco comme exutoire pour faire de la musique perso m’a probablement poussé à faire un disque solo. Ma vie a radicalement changé du jour au lendemain. Je suis passé d’un mode de vie où je voyageais presque tout le temps à un mode de vie où je sortais à peine de chez moi. »
Lentement mais sûrement, son disque dur s’est retrouvé plein d’expérimentations sonores et c’est alors qu’une épiphanie s’est produite : « Je collabore sans cesse (même avec SMD, tout ce que je fais est une collaboration) mais que se passerait-il si je terminais un projet tout seul ? Je me suis dit : “Purée, je suis peut-être en train de faire un disque solo. ” C’est bizarre de se dire çà à 40 ans. »
Il avoue qu’au départ, la tentation de faire défiler son iPhone et d’appeler à l’aide des personnes qu’il connaissait était forte : « Je faisais des morceaux et je me disais : “Je vais peut-être envoyer ça à Alex Turner (Arctic Monkeys).” L’idée de faire un album avec beaucoup d’invités m’a vraiment traversé l’esprit, mais j’ai trouvé plus courageux de le faire tout seul. »
C’est ainsi qu’il s’est soudain retrouvé lancé dans un disque solo sur lequel il a fait absolument tout. Piano, Wurlitzer, Clavinet, clarinette basse, flûte, sax ténor, Serge Modular, ARP 2600, Maxikorg, Oberheim, hammered dulcimer, violoncelle, orgue Philicorda et vibraphone : la liste des instruments est longue, – sans oublier la basse, la batterie et les guitares. En fait, James a appris la clarinette basse spécialement pour cet album. Il cite ses années passées à Manchester avant Simian, s’imprégnant de l’attitude positive de Graham Massey, des légendes de l’acid house 808-State, et de l’artiste hors-normes Paddy Steer, comme influences massives, mais il s’est également tourné vers les disques marquants d’auteurs multi-instrumentistes aussi excentriques que Todd Rundgren, Haruomi Hosono, Nick Lowe et Ivor Cutler.
Avoir son propre studio pour ses expérimentations lui a donné une telle confiance qu’il jouait tout en direct, sans séquençage, sans logiciels et sans pilotage numérique. La musique a été enregistrée directement sur bande, au premier ou au deuxième passage, ce qui lui confère une immédiateté vitale : « Avec la technologie, il est facile de corriger les “erreurs” après coup, et je déteste vraiment ce point auquel nous sommes arrivés dans l’histoire de l’enregistrement. En raison du cauchemar de l’IA qui se profile, l’humanité est la qualité principale que l’on peut apporter à un disque. »
Mais jouer tout lui-même était facile comparé au fait de devoir chanter : « J’avais jamais chanté en public avant. Jamais fait de karaoké. Je chante même pas sous la douche ! Je dis toujours aux artistes de s’appuyer sur leur vulnérabilité [en studio] et j’ai soudain dû appliquer certaines de ces idées à moi-même. J’ai fini par goûter à mon propre remède ! »
Selon lui, l’écriture des paroles est l’élément le plus compliqué de toute l’entreprise : « Les paroles concernent pour beaucoup mon adaptation aux changements de la vie : devenir père, vieillir, mon ami qui tombe malade. Avoir des enfants est un changement de paradigme gigantesque et positif (on n’est plus le centre du monde), mais cet événement et la situation avec Jas m’ont fait réfléchir à ma propre mortalité pour la première fois. Les paroles traitent de ce changement et sont empreintes de nostalgie face au temps passé, mais je regarde aussi le monde dont mon fils va hériter avec un sentiment d’inquiétude de plus en plus grand. Je suis assez préoccupé par la corde raide sur laquelle notre espèce avance. »
Il a ressenti de la joie lorsque le projet a été signé chez Warp : « Broadcast est un de mes groupes préférés et Aphex Twin un de mes artistes de chevet. Au début de Simian, Jas et moi on était très proches d’Autechre. Même avant ça, un jour Warp a téléphoné pour dire qu’ils allaient venir nous voir jouer. J’avais jamais été aussi excité de ma vie. Donc le fait que The Hum sorte chez Warp, pour moi c’est une façon de boucler la boucle. C’est mon label préféré. »
« Intro », qui ouvre l’album, tout comme « The Hum », sont deux expériences de bandes magnétiques luxuriantes et en muiltiples couches qui servent d’indices archéologiques sur la façon dont le projet sonnait à l’origine. Dans sa totalité, l’album était initialement une collection de morceaux ambient très texturés, influencés par Harold Budd et la collaboration révolutionnaire entre Brian Eno et Robert Fripp, NoPussyfooting. Le son vaporeux et aérien a été obtenu à l’aide de deux magnétophones reliés l’un à l’autre, en utilisant une énorme boucle de bande qui serpentait autour des pieds de micro disséminés dans son studio.
L’ambiance tranquille, béate et hypnotique de « Pillow Village » donne le ton de l’album, en un point d’équilibre majestueux, plein d’amour mais aussi de mélancolie ; un joyeux tranquillisant enregistré sur bande, avec des motifs d’accords qui évoluent lentement, rappelant les morceaux somnambuliques du Live-Evil de Miles Davis, mais aussi le rock progressif que son père mettait quand il était jeune, – Gentle Giant, Soft Machine et Caravan. « I Never Wanted Anything » évoque la prise de conscience, à l’âge mûr, que la plupart des opportunités de la vie commencent à s’éloigner, mais que ce n’est pas un problème. « Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réussi à continuer ce que je fais, confie James. Quand je fais de la musique et que j’ai le sentiment que ça va être génial ? C’est littéralement l’excitation que je recherche chaque jour. » L’esprit d’Another Green World de Brian Eno flotte en arrière-plan : « C’est un disque d’île déserte, une sécurité intégrée. On a eu la chance de travailler avec Eno sur le deuxième album de Simian, juste au moment où j’envisageais de passer à la production, et cette expérience nous a permis de voir comment son attitude modifiait les choses. Ce qu’il fait [sur les premiers disques solos] est assez ludique, limite zinzin par endroits, mais c’est d’une profondeur artistique que j’aime et qui m’a attiré tout au long de ma vie. »
« The Yips » est centré sur un groove massif à la Can (« Ouais, Jaki Liebezeit est un héros intemporel ! ») mais, géographiquement et musicalement, l’influence majeure n’est pas allemande mais moyen-orientale : « Ma femme est à moitié palestinienne et mon fils a des racines palestiniennes, alors il y a quelques années j’ai visité les territoires occupés en ressentant un besoin de connexion avec les gens qui y vivent et avec leur culture. C’était à la fois exaltant et incroyablement déprimant. J’ai rencontré beaucoup de musiciens enthousiasmants, jeunes et vieux, qui essayaient simplement de vivre et de faire de la musique dans des circonstances très difficiles. »
Les paroles de « Golden Hour » traitent du satori, un terme bouddhiste japonais qui évoque la compréhension du tout, un état de conscience élevé qui peut survenir pendant la méditation ou une expérience psychédélique : « Tout est disposé en parfaite harmonie. Tout devient clair, mais quand on revient à la réalité, on essaie de s’accrocher au sens de tout ça et on se dit : “Attends, ça n’a plus aucun sens.“ On tenait le sens de la vie dans les mains et il a glissé entre nos doigts. » Avec le monstre funk-rock « Caterpillar », James a voulu se débarrasser de l’impression qu’il n’était qu’un gars dans un studio qui se chantait des chansons et a imaginé un groove titanesque comme s’il avait été « fait par une bande de dingues dans une pièce, genre Parliament-Funkadelic ou [le supergroupe prog] Rhinoceros. »
Il garde cependant le moment de bravoure pour la fin. « Closing Time » est une ballade intemporelle et mélancolique qui pourrait facilement figurer sur un classique de Robert Wyatt ou de Paul McCartney. Il y est question en apparence des dernières commandes passées dans un pub, mais avec un sous-texte clair sur le caractère éphémère de la vie et l’avenir de l’humanité elle-même : « J’aime les chansons à l’eau de rose, mais en écrire une m’a demandé d’aller tellement au-delà de ma zone de confort. Je me suis dit : “Tu te reprends et t’y vas !” Il y est question du vieillissement et de l’acceptation de la mort. On n’ en parle pas vraiment dans la société occidentale, mais il est sain de trouver un moyen de se sentir à l’aise avec la mort, d’essayer de se débarrasser de la peur qu’on en a. Le monde change rapidement et une partie du problème est que les gens ne peuvent pas y faire face. Ils ne peuvent pas laisser les choses aller et passer à autre chose. »
Lorsqu’on lui demande s’il a l’impression que cet album lui donne l’occasion de dire quelque chose de fondamental sur lui-même pour la première fois, James Ellis Ford acquiesce vigoureusement : « Oui, je pense, et c’est peut-être pour ça que qu’il me rend si nerveux. Il est aussi proche de moi qu’il peut l’être, sans que j’aie besoin de tout dire. » Mais il devrait être apaisé : avec The Hum, il est enfin sous les feux de la rampe.